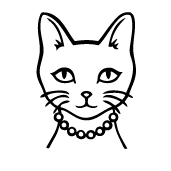Le 26 avril 1798, Eugène Delacroix est né à Charenton.

Eugène Delacroix, Autoportrait au gilet vert. Vers 1837. Huile sur toile. 65 x 54 cm. Musée du Louvre © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel Urtado
Jeunesse. – Le 7 floréal an VI, Eugène est né dans une famille bourgeoise à Charenton-Saint-Maurice. Son père, Charles-François Delacroix, a fait une brillante carrière politique et administrative : avocat au Parlement, secrétaire de Turgot, membre de la Convention nationale, ministre des relations extérieures sous le Directoire avant de laisser la place à Talleyrand et d’être nommé ambassadeur en Hollande à titre de compensation. Préfet à Marseille puis à Bordeaux, il meurt en 1805. Neuf ans plus tard, sa mère, Victoire Oeben, qui vient d’une famille d’artistes – ébénistes et peintres -, meurt à son tour. La famille sort ruinée de la succession.
Elève au lycée Louis-le-Grand à partir de 9 ans, le jeune Eugène a des dispositions pour la musique et le dessin. « Dès sa huitième et neuvième année, cet artiste merveilleux reproduisait les attitudes, inventait les raccourcis, dessinait et variait les contours, poursuivant, torturant, multipliant la forme sous tous les aspects avec une obstination semblable à de la fureur » rapporte son camarade de collège, Philarète Chasles.
Journal de Delacroix. – Laissons plutôt parler l’artiste. Voici ce qu’il écrit de lui-même dans son Journal :
« Je me souviens que quand j’étais enfant, j’étais un monstre. La connaissance du devoir ne s’acquiert que très lentement, et ce n’est que par la douleur, le châtiment et par l’exercice progressif de la raison, que l’homme diminue peu à peu sa méchanceté naturelle ».
« Ce qu’il y a de plus réel en moi, ce sont ces illusions que je crée avec ma peinture. Le reste est un sable mouvant ».
« Presque tous les grands hommes ont eu une vie plus traversée, plus misérable que celle des autres hommes ».
« L’homme est un animal sociable qui déteste ses semblables ».
« La gloire n’est pas un vain mot pour moi. Le bruit des éloges enivre d’un bonheur réel ; la nature a mis ce sentiment dans tous les cœurs. Ceux qui renoncent à la gloire ou qui ne peuvent y arriver font sagement de montrer, pour cette fumée, cette ambroisie des grandes âmes, un dédain qu’ils appellent philosophique. Dans ces derniers temps, les hommes ont été possédés de je ne sais quelle envie de s’ôter eux-mêmes ce que la nature leur avait donné en plus qu’aux animaux qu’ils chargent des plus vils fardeaux. »
La peinture est le métier le plus long et le plus difficile ; il lui faut l’érudition comme au compositeur, mais il lui faut aussi l’exécution comme au violon.“

Eugene Delacroix (1798-1863), George Sand habillee en homme, 1834, huile sur bois, 26 x 21,5 cm, Coll. musee national Eugène-Delacroix © Musee du Louvre, dist. RMN – Grand Palais / Philippe Fuzeau
Une amitié profonde.- Eugène Delacroix et George Sand se rencontrent en novembre 1834. A la demande de François Buloz, directeur de la Revue des Deux Mondes, le peintre réalise le portrait de l’écrivain pour illustrer les articles de celle-ci dans la revue. George qui a rompu avec Alfred de Musset vient de couper sa longue chevelure en signe de désespoir.
Delacroix, qualifié de “plus charmant garçon qu’il y ait au monde” par Sand, a dix ans de moins qu’elle. Une grande amitié naît entre le peintre et la romancière.
« Cher vieux, comme c’est aimable à vous d’écrire à votre vieille sœur ! Votre cœur est bien bon, bien grand, cher ami et vos yeux sont bien noirs, bien vifs, bien pénétrants. Vous le savez bien, je serais folle de vous, si je ne l’étais d’un autre [Chopin] et peut-être que vous m’aimeriez plus que tout, si d’autres fantômes en jupons ne dansaient plus gracieusement et plus coquettement, la nuit, sous le berceau de vos allées. […]
Restons bohémiens, cher œil noir, afin de rester artistes ou amoureux, les deux seules choses qu’il y ait au monde. L’amour avant tout, n’est-ce pas ? L’amour avant tout quand l’astre est en pleine lumière, l’art avant tout, quand l’astre décline. Tout cela n’est-il pas bien arrangé ? » (lettre du 7 septembre 1838).
Delacroix passe les étés 1842, 1843 et 1846 à Nohant où vit George en compagnie de Frédéric Chopin, de Maurice à qui il enseigne la peinture et de Solange, les enfants de la femme de lettres ainsi que de nombreux amis de passage.
“Bonsoir donc, mon bon petit. Tout le monde dort, mais tout le monde me demandera demain matin si je vous ai embrassé pour chacun, et si je vous ai bien dit que tous vous aimaient tendrement. Moi, dans le tête-à-tête, je vous embrasse pour tous et pour moi encore plus fort » (Lettre du 14 juillet 1842)
Durant le mois de juin 1842, Delacroix peint L’Education de la Vierge qu’il offre à son amie.
« La toile a été prise dans ma toilette, c’était un coutil de fil destiné à me faire des corsets. Pendant qu’il faisait cette peinture, je lui lisais des romans. Ma bonne [Françoise Caillaud] et ma filleule [Augustine Brault] posaient. Maurice copiait à mesure pour étudier le procédé du maître.» (lettre de Sand à Edouard Rodrigues, 24 février 1866)
L’été 1843, Delacroix est de retour ; il repart en août travailler aux peintures murales de la bibliothèque du Palais-Bourbon qui seront achevées en 1847. En novembre, l’artiste est malade.
“J’ai ici en ce moment mon ami Delacroix qui est un charmant et excellent homme, mais qui me croit folle au 40ème degré, quand par hasard je dis que nous sommes tous des scélérats. […] Delacroix couvre des toiles avec de la superbe couleur.» (lettre à Pierre Bocage du 20 juillet 1843)
« Je vois dans les journaux que les travaux de la Chambre doivent être finis pour la prochaine session. Vous allez en abattre et du bon. J’espère que cet hiver, vous me permettrez d’y mettre le nez ». (Lettre à Delacroix du 13 août 1843)
« Si vous étiez entre mes mains, je vous soignerais si bien que je vous rendrais fort comme un Turc. Vous m’écouteriez peut-être un peu mieux que Chopin à qui tous mes soins n’ont pu faire pousser l’ombre d’un mollet. Pauvre cher ami, guérissez donc vite, afin de venir m’embrasser bientôt rue St-Lazare.” (lettre du 4 novembre 1843)
Outre l’ami cher, Sand apprécie beaucoup les toiles du peintre et ne manque pas de lui faire savoir.
« Je me retrempe un peu avec ma sainte Anne et ma petite Vierge. Je les regarde en cachette quand je me sens défaillir, et je les trouve si vraies, si naïves, si pures que je me remets au travail avec de beaux types et des idées fraîches … » (Lettre à Delacroix du 14 juillet 1842)
« Je ne plante pas un brin d’herbe sans penser à vous, sans me rappeler comme vous aimez et comme vous appréciez les fleurs, et comme vous les sentez, et comme vous les comprenez, et comme vous les peignez. Mon beau vase [tableau de fleurs] peint par vous est encadré. Je ne l’ai pas déplacé malgré votre avis parce que si je le mets au-dessus de moi, à l’endroit où je travaille, je suis forcée de me donner un torticolis pour le voir. Au lieu que là où il est, je le vois de mon lit en m’éveillant et de ma table en écrivant, et de partout. C’est mon point de mire. Il n’y a pas une fleurette, un détail qui ne me rappelle tout ce que nous disions pendant que vous étiez à votre chevalet. » (Lettre du 4 novembre 1843)
« Cette belle Sainte-Anne et cette douce petite Vierge [L’éducation de la vierge] me font du bien, et quand quelqu’un vient m’embêter, je les regarde et n’écoute pas. […] Mon cher grand artiste […] vous avez trop d’imagination et d’émotion à dépenser tout seul […] Chopin m’interrompt là-dessus, pour me dire qu’il vous adore, ce que je vous fais passer tout chaud. » (lettre du 11 octobre 1846)
« Cher ami, encore bon jour, et bon an, et bonne santé pour que vous ayez beau et grand succès en toutes choses. Notre Lélia est une chose admirable et si le public de Nohant n’est pas nombreux, au moins il est chaud. Je voudrais que vous entendissiez les joies et les exclamations de ces belles surprises.” (Lettre de janvier 1853)
“J’ai revu toute votre œuvre, je n’ai guère regardé autre chose, et je suis sortie de là vous mettant toujours, sans hésitation et sans crainte d’aucune partialité, à côté des plus grands dans l’histoire de la peinture et au-dessus, mais à deux cent mille pieds au-dessus de tous les vivants.
En rentrant chez moi, j’ai trouvé l’épreuve du chapitre de mes mémoires que j’avais écrit à Nohant avant mon départ. Je l’ai relu bien tranquillement et loin d’avoir à en retrancher un mot, j’en aurais mis le double si je n’avais craint de vous faire assassiner. J’ai dû me faire pas mal d’ennemis dans la peinture, mais je m’en fiche pas mal aussi. » (lettre du 25 juillet 1855).« J’ai été voir votre chapelle à Saint-Sulpice. C’est splendide. Je vous admire plus que jamais et je vous aime comme toujours. Je ne partirai pas sans aller vous voler encore un quart d’heure et vous embrasse avec Maurice que j’attends » (Mot écrit à Paris, le 4 avril 1862).
Deux lettres, l’une de 1853 adressée à Delacroix, l’autre du 17 août 1863 adressée à Edouard Rodrigues, quatre jour après le décès du peintre, sont un vibrant témoignage de l’amitié sincère et de la grande admiration que porte Sand à Delacroix.
Cramponnez-vous aussi. Il faut que nous vivions les uns pour les autres, que nous vieillissons avec nos amis ou bien la lutte sera cruelle. Pour vous, vous êtes dans tout l’éclat, dans toute la puissance de votre œuvre. Vous avez gagné une bataille mémorable en ce siècle de bourgeoisie renforcée, et de scepticisme vaniteux. Votre empire est fait, et ceux qui n’ont jamais douté de vous sont plus fiers de votre gloire que vous-même. A revoir dans un ou deux mois, cher ami. J’irai vous embrasser comme je vous aime. » (Lettre de janvier 1853)
« Oui, j’ai le cœur navré. J’ai reçu de lui le mois dernier une lettre où il me disait qu’il prenait part à notre joie d’avoir un enfant, et où il me parlait d’un mieux sensible dans son état. J’étais si habituée à le voir malade que je ne m’en alarmais pas plus que de coutume. Pourtant sa belle écriture ferme était bien altérée. Mais je l’avais déjà vu ainsi plusieurs fois. Mon brave ami Dessauer était près de nous quelques jours plus tard. Il l’avait vu. Il l’avait trouvé livide, mais pas tellement faible qu’il ne lui eût parlé longtemps de moi et de nos vieux souvenirs, avec effusion. J’ai appris sa mort par le journal ! C’est un pèlerinage que je faisais avec ma famille et avant tout, chaque fois que j’allais à Paris. Je ne voulais pas qu’il fût obligé de courir après moi qui ai toujours beaucoup de courses à faire. Je le surprenais dans son atelier. « Monsieur n’y est pas ! » – Mais il entendait ma voix et accourait en disant : « Si fait, si fait, j’y suis ». Je le trouvais, quelque temps qu’il fît, dans une atmosphère de chaleur tropicale et enveloppé de laine rouge jusqu’au nez, mais toujours la palette à la main, en face de quelque toile gigantesque ; et après m’avoir raconté sa dernière maladie d’une voix mourante, il n’animait, causait, jetait son cache-nez, redevenait jeune et pétillant de gaîté, et ne voulait plus nous laissait partir. Il fouillait toutes ses toiles et me forçait d’emporter quelque pochade admirable d’inspiration. La dernière fois l’année dernière (quand je vous ai vu) j’ai été chez lui avec mon fils et Alexandre Dumas fils, de là, nous avons été à Saint-Sulpice, et puis nous sommes retournés lui dire que c’était sublime, et cela lui a fait plaisir. C’est que c’est sublime en effet, les défauts n’y font rien, et puisque vous comprenez cela, vous comprenez le beau et le grand plus que les trois quarts des gens qui se disent artistes ou qui le sont de profession. Vous êtes aimable de me parler de lui, et vous partagez mes regrets comme vous partagez mon admiration. Pauvre cher pèlerinage, nous ne le ferons plus. Mon fils, qui a été son élève et un peu son enfant gâté, est bien affecté. » (Lettre à Edouard Rodrigues, 18 août 1863).
Sources : George Sand, Lettres d’une vie, Choix et présentation de Thierry Bodin, Folio classique.