Hommage à Notre-Dame de Paris.-
Un opéra : La Esmeralda de Louise Bertin.

Louise Bertin
Résumé. – Née le 15 février 1805 et décédée le 26 avril 1877, Louise Bertin, est une compositrice trop méconnue du XIXe siècle, créatrice de plusieurs opéras: Le loup garou, Guy Mannering, Fausto et surtout La Esmeralda, initialement intitulé Notre-Dame de Paris, inspiré du roman de Victor Hugo et dont le livret a été composé par l’écrivain lui-même. Chanté par la grande soprano Cornélie Falcon, les ténors Alfred Nourrit et Eugène Massol ainsi que la basse Nicholas Prosper Levasseur, l’opéra, joué à l’Académie musicale royale, n’a tenu que 6 représentations entre le 16 novembre et le 16 décembre 1836. La misogynie du public de l’époque, le refus de certains de voir Victor Hugo en simple librettiste et la possibilité offerte à certains d’atteindre le puissant Bertin, patron du Journal des Débats, par l’intermédiaire de sa fille Louise, ont contribué à faire disparaître rapidement cet opéra de la scène, opéra qui se révèle pourtant aujourd’hui très moderne et mérite d’être redécouvert.

Portrait de Louis-François Bertin – Ingres
Famille.- Louise Bertin est née le 15 février 1805 dans un milieu cultivé. Son père Louis-François Bertin et son oncle dit Bertin de Vaux dirigent Le Journal des Débats ; sa mère Geneviève Boutard est pianiste. Ses parents tiennent salon dans leur château des Roches à Bièvres dans l’Essonne où ils reçoivent Victor Hugo, Chateaubriand, Rossini, Meyerbeer et Berlioz ainsi qu’Ingres et Delacroix. A la mort de Louis-François en 1841, les deux fils, Edouard et Armand, prennent la direction du journal. Edouard devient inspecteur des Beaux-Arts tandis qu’Armand est membre de la Commission de l’Opéra.
Influente sous la Monarchie de Juillet, la famille est très soudée autour de Louise, handicapée à la suite d’une poliomyélite dans son enfance. Dotée d’une jolie voix de contralto, la jeune femme apprend la composition avec François-Joseph Fétis et le contrepoint et la fugue avec Anton Reicha. Elle veut devenir compositrice, comme le rappelle Fétis dans ses Mémoires :
« Elle brulait du désir d’écrire un opéra ; mais il n’entrait pas dans sa tournure d’esprit de commencer pour cela par apprendre l’harmonie ni le contrepoint ; il dut lui enseigner à écrire des airs, des morceaux d’ensemble et des ouvertures comme on lui avait montré à faire des tableaux […]. Mlle Bertin écrivait ses idées, qui, insensiblement, prenaient la forme du morceau qu’elle voulait faire ; l’harmonie se régularisait de la même manière, et l’instrumentation, d’abord essayé d’instinct et remplie de formes insolites, finissait par rendre la pensée du jeune compositeur. » (Fétis, t. I, p. 414).
Création musicale.- Mais la création musicale est une activité essentiellement masculine, tant elle est considérée au XIXe siècle comme incompatible avec la « nature féminine ». Dans la classe bourgeoise en effet, la femme est cantonnée à un rôle d’épouse et de mère, chargée de s’occuper de ses enfants et de les éduquer. Seules les cantatrices – domaine où les femmes sont irremplaçables – et les hôtesses de salons musicaux sont acceptées, les premières sur la scène, les secondes dans un cadre domestique en leur qualité de maîtresse de maison. L’éducation musicale qui est donnée aux jeunes filles de la bourgeoisie est essentielle, mais limitée ; la plupart des instruments – exception faite du piano – leur sont interdits. Il faut ainsi attendre 1861 pour qu’une femme soit lauréate d’une classe d’écriture musicale au Conservatoire de Paris.
Les compositrices au XIXe siècle vont donc être issues de milieux artistiques ou de familles de l’aristocratie et de la bourgeoisie intellectuelle, le plus souvent d’origine parisienne, qui vont pouvoir leur donner une éducation musicale poussée. Tel est le cas de Louise Bertin qui, soutenue et encouragée par toute sa famille, et grâce au puissant réseau de relations familiales, va pouvoir écrire des opéras et les faire jouer sur les scènes lyriques parisiennes.

Victor Hugo – Léon Noël (1832)
Début de la collaboration.- C’est en 1831 que Louise Bertin demande à Victor Hugo de tirer un livret d’opéra de son roman Notre-Dame de Paris. La compositrice a déjà écrit deux opéras comiques – Le loup-garou et Guy Mannering – et vient de composer Fausto, sur un livret qu’elle a écrit d’après Goethe, donné pour trois représentations seulement au Théâtre-Italien. Et alors que Victor Hugo a refusé cette même demande formulée par Rossini et Meyerbeer, il accepte pour son amie.
Une amitié profonde lie la compositrice et l’écrivain, comme en témoigne cette lettre écrite par le poète quand il apprend la noyade de sa fille Léopoldine :
« Chère Mademoiselle Louise,
Je souffre, j’ai le cœur brisé ; vous le voyez, c’est mon tour. J’ai besoin de vous écrire, vous qui l’aimiez comme une autre mère. Elle vous aimait bien aussi, vous le savez. […]
Pardonnez-moi, je vous écris dans le désespoir. Mais cela me soulage. Vous êtes si bonne, vous avez l’âme si haute, vous me comprendrez, n’est-ce pas ? Moi, je vous aime du fond du cœur, et quand je souffre je vais à vous. »
Après la suspension des représentations du Roi s’amuse en 1832, Hugo propose à Louise Bertin de renoncer au projet et obtient cette réponse :
« Monsieur, j’ai beaucoup souffert depuis 8 jours, mais comment avez-vous pu croire un seul instant que je renoncerais à Notre-Dame de Paris pour quoi que ce soit au monde. J’ai de l’amour-propre, Monsieur, et j’aime mieux tomber avec le premier, que réussir avec un autre. Si vous avez jamais remarqué en moi quelques hésitations, vous savez bien qu’il faut les attribuer au sentiment que j’éprouve à vous voir vous occuper d’un travail si au-dessous de votre génie. Comment, moi qui n’admire que vous au monde, pourrais-je refuser l’honneur de mettre mon nom à côté du votre ? ».
Hugo librettiste.- Victor Hugo a dû simplifier l’histoire aux besoins de l’opéra et adapter son style à la musique composée par Louise Bertin au fur et à mesure de l’avancée du livret. De son côté, Louise tente de s’adapter au rythme du vers de Victor Hugo, tout en avouant qu’elle n’y parvient guère :
« J’ai reçu Notre-Dame de Paris. Je remercie ton papa pour ce qui est imprimé, et pour ce qui est écrit. J’ai le cœur le plus navré que jamais des outrages que je fais subir à ce bel ouvrage. Je voudrais que le public, au lieu de mes duos et de mes trios se fit lire l’admirable chapitre sur l’architecture. Comment rendre en musique Claude et Quasimodo traversant silencieusement les rues de Paris ? seuls au milieu de tous, ces deux exceptions presque aussi malheureuses l’une que l’autre ? C’est impossible. Il faut donc renoncer à cela, ôter l’alchimie à Frollo, une bosse ou deux à Quasimodo. C’est un massacre ! et j’en suis complice ! » (Lettre à Léopoldine Hugo).
L’Opéra.- Le titre Notre-Dame de Paris est cependant abandonné au profit de La Esmeralda. La censure a refusé de voir sur scène un prêtre amoureux et assassin ; le mot « prêtre » a été supprimé et transformé en magistrat ! La Esmeralda est donnée à l’Académie royale de Musique – l’opéra Garnier a, rappelons-le, été créé en 1869 -. Composé par une femme – fait extraordinaire repris par tous les journaux de l’époque – et écrit par le grand poète, l’opéra attise la curiosité et attire la foule.
« Une jeune femme écrivant un grand opéra, et de la même main qui pourrait filer une quenouille ou broder curieusement un mouchoir, une écharpe, construisant l’édifice colossal d’une partition ; gouvernant à sa fantaisie toutes les puissances sonores d’un théâtre lyrique, pour combiner les effets d’orchestre avec les résultats des voix récitantes et chorales ; assaisonnant les douces tenues des flûtes, des bassons, des clarinettes, avec les accords heurtés des trombones, le pizzicato des contrebasses, le tremolo des violes, les trilles des violons, c’est prodigieux, cela ne s’est jamais vu ! Ce théâtre, où les musiciens les plus habiles n’arrivent qu’après des triomphes obtenus en d’autres lieux, n’avait point encore ouvert ses portes à des musiciennes. Voilà ce que disaient bon nombre d’habitués de l’Opéra le soir de la représentation de La Esmeralda. Ces amateurs ne craignaient pas de manifester avec franchise un étonnement qui ne faisait point honneur à leur érudition. Une demoiselle écrire un grand opéra ! Pourquoi pas ? Mme Gail, Mlle Loïsa Puget, n’ont-elles pas composé des opéras-comiques ? Une jeune femme tracer des marches d’harmonie, ajuster des groupes d’instruments de cuivre, et faire manœuvre la grosse artillerie de l’orchestre ! pourquoi pas ? » (Castil-Blaze)
Succès.- La première a lieu le 16 novembre chanté par les grands interprètes de l’époque : dans le rôle d’Esmeralda, la soprano Cornélie Falcon (1814-1897) ; dans le rôle de Phoebus, le ténor Alfred Nourrit (1802-1839) ; dans le rôle de Quasimodo, le ténor Eugène Massol (1802-1887) ; dans le rôle de Frollo, la basse Nicholas Prosper Levasseur (1791-1871).
« Le succès du nouvel opéra a dépassé toutes nos espérances : non seulement, il a été applaudi, mais encore il a été écouté avec une émotion toujours croissante. Mes éloges ont attendu, et Dieu sait cependant si cette attente m’a coûté, que des juges plus impartiaux se fussent rangés du côté de l’œuvre nouvelle. Mais aujourd’hui que l’opinion publique semble adopter La Esmeralda, aujourd’hui que la presse entière n’a qu’une voix pour proclamer l’incontestable mérite de cet ouvrage, après une seconde épreuve plus difficile peut-être, mais non moins éclatante, non moins heureuse et non moins décisive que la première, il me semble que moi-même, malgré toutes mes préventions favorables et si légitimes, j’ai bien le droit de parler de l’opéra de Mlle Bertin. » (Jules Janin, Journal des Débats, 17 novembre 1836).
« L’air de Quasimodo, le chant du sonneur qui se réjouit en entendant les cloches, est un tableau musical achevé ; les images pittoresques de l’orchestre, le rythme original et plein de franchise de l’accompagnement, la belle voix de Massol dominant cet ensemble, attaqué de part d’autre avec toute la verve que Mlle Bertin a su lui imprimer, ont excité des transports d’enthousiasme. Un tonnerre d’applaudissements a signalé la dernière cadence du chanteur, il n’a cessé de gronder que pour laisser le cham libre aux réclamations les plus flatteuses et les plus unanimes. Bis ! Bis ! s’est-on écrié de toutes parts ; Massol a répété son air avec un nouveau succès, et ce bis est maintenant de tradition ; l’air de Quasimodo fait fortune à l’Opéra, il va bientôt paraître au concert ; il deviendra populaire. » (Castil-Blaze)
Échec.- La dernière a lieu le 16 décembre 1836, six représentations plus tard. L’opéra est un scandale retentissant, une sorte de « bataille d’Hernani de l’opéra » (L. Régnier et A. Laster).
« Je ne crois pas que depuis Gluck et Piccini, à cette heureuse époque où l’on avait le temps de se haïr et de se battre au nom de la musique, jamais opéra ait soulevé plus de haines et de sympathie, ait rencontré plus de soutiens et aussi plus d’opposants, que l’opéra de Mlle Bertin.
Cette fois toutes les traditions de l’Opéra sont changées. Ordinairement, pour l’Opéra comme tout ce qui est théâtre à Paris, c’est la première représentation qui décide du succès ou de la chute d’un ouvrage. » (Jules Janin, Journal des Débats, 21 novembre 1836).
« Cette pièce trop applaudie et trop sifflée a fait sortir le public de l’opéra de ses convenances accoutumées » (Le Figaro, 23 novembre 1836).
« Toutes nos craintes ont été dépassées ; mais, ô ciel ! qui pouvait prévoir tant de fureurs ? Nous savions bien quelles haines terribles et cachées devaient accueillir ce bel ouvrage ; mais pourtant il nous était impossible de prévoir que cette haine impitoyable imposerait silence à toute une assemblée qui écoutait et qui applaudissait en toute conscience ; les mélodies charmantes et originales auraient trouvé grâce, à coup sûr, devant les spectateurs les plus prévenus, s’il se fût agi seulement d’un lauréat de l’Institut ou de tout autre artiste inconnue. […] Mais cette fois encore, à leur grand chagrin, ils ont trouvé une salle remplie jusques aux combles, une foule attentive ; on écoutait, on applaudissait ; pendant trois actes cette imperceptible et envieuse minorité a été forcée au silence par l’attitude sérieuse et bienveillante de l’auditoire. Encore un instant, et l’opéra était sauvé. D’habiles et utiles coupures avaient été faites dans les cérémonies du dernier acte, tout était dit, quand soudain de furibondes clameurs s’élèvent de diverses parties de la salle des cris : A bas la toile ! se font entendre. Les spectateurs étonnés regardent de tous côtés d’où viennent ces cris furieux ; mais aujourd’hui le vrai public a si fort oublié tous ses droits, qu’il ne sait ni siffler, ni applaudir. Bref la fureur augmente, les acteurs se troublent ; Mlle Falcon s’enfuit, la toile tombe avec tant de précipitations, qu’on eût dit qu’elle obéissait à ces ignobles hurlements. Et voilà comment cette dernière victoire a été arrachée à La Esmeralda au milieu d’une salle remplie jusqu’aux combles, avec une recette de huit mille cinq cents francs, en présence des mêmes spectateurs qui avaient applaudi ces trois actes, et qui restaient étonnés et confondus de l’insolent démenti qui leur était donné !
Je ne sais pas encore quel sera le résultat de cette soirée. La Esmeralda voudra-t-elle encore en venir aux mains avec des ennemis si acharnés et si lâches ? Mlle Falcon voudra-t-elle se souvenir que Mlle Mars, cet illustre et inimitable modèle, à peu près dans les mêmes circonstances et en butte aux mêmes clameurs, forte de l’assentiment public, de sa propre conscience et de son dévouement à l’œuvre insultée, a tenu tête vingt fois de suite à un parterre déchaîné, et l’a enfin réduit au silence et à l’admiration, à force d’énergie, de talent et de volonté ? Voilà ce que j’ignore encore. Mais ce que je sais très bien ; c’est qu’il n’y eut jamais, dans nos annales dramatiques, de fureur pareille à celles qui poursuivent La Esmeralda. C’est que les passions politiques les plus acharnées et les plus violentes devraient être honteuses de s’être ainsi attaquées à une œuvre si originale. » (Jules Janin, Journal des Débats, 19 décembre 1836).
Critique déchaînée.- Entre la première et la dernière représentation, la critique s’est déchaînée. Principalement misogyne d’abord. En voici un exemple particulièrement représentatif avec Henry Blaze de Bury dans la Revue des deux mondes :
« […] le talent de Mlle Louise Bertin, malgré son apparente virilité, est plutôt suave que fort, plutôt mélancolique et tendre que véhément et passionné. Je ne crois pas à cette teinte sombre qu’elle exagère délibérément et comme à plaisir ; là n’est point sa véritable inspiration. Étrange ambition, qui préoccupe les cerveaux les mieux faits. On n’a de cesse qu’on n’ait dépouillé son sexe ou renié sa nature. Un beau jour, celles qui doivent tout à leur souffrance aimable, à leur résignation, à leur foi sincère et catholique, se prennent de bel amour pour la force et la protestation, et, dépouillant cette mélancolie sereine et douce qui va si bien à la pâleur de leur visage, revêtent on ne sait quel semblant de dogmatisme et de virilité. Les insensées ! qui oublient dans leur enthousiasme que changer de sexe c’est répudier en quelque sorte son humanité. Qu’arrive-t-il ? Les femmes qui les adoraient comme l’expression de leurs plaintes inoffensives, s’éloignent d’elles, trouvant désormais leur organe rauque et maussade ; quant aux hommes, ils se prennent à sourire, en entendant Jérémie ou Savonarole prêcher la ruine de l’univers avec une voix de faucet. Oh ! si les femmes voulaient rester là où Dieu les a mises, et ne point rompre avec leur caractère, comme il y en aurait parmi elles de sublimes vers qui se tournerait la commune sympathie, plus puissantes cent fois dans leur faiblesse divine que dans leur force. Qu’est-ce donc que les femmes cherchent hors des limites de leur nature ? elles ont l’amour et les larmes. Quel bien vaut ici bas ces inappréciables trésors qu’elles tiennent du ciel et que les plus grands poètes leur envient ? […]
Une femme, quels que soient d’ailleurs son aptitude, son énergie et son courage ne parviendra jamais à cette force de modération qu’exige le gouvernement de l’orchestre. Sa nature même s’y oppose ; son visage gracieux se riderait à cette peine ; ses blanches tempes se flétriraient à ce travail ingrat. Lorsqu’une femme est assez heureuse pour avoir reçu du ciel la fleur de la mélodie, il faut qu’elle la respire au lieu de l’effeuiller dans le lac tumultueux de l’orchestre ; il faut qu’elle chante et ne cesse de chanter, comme les maîtres d’Italie ou comme l’oiseau du printemps, peu importe. […]
Maintenant, avec les qualités réelles que nous nous plaisons à lui reconnaître, et les éclairs dramatiques qui traversent ses partitions, Mlle Bertin est-elle destinée à composer pour le théâtre ? Franchement, nous ne le croyons pas. Il y a dans le talent des femmes une corde suave et douce qui en fait presque tout le charme, et dont la vibration se perd dans les vastes salles. Cette mélodie, qu’on sait naturellement délicate et dont on aime jusqu’à la faiblesse, a mauvaise grâce à vouloir enfler sa voix pour exprimer autre chose que la mélancolie et les tendres affections de cœur. On est tenté à tout moment d’arracher le masque qui recouvre ces beaux yeux languissants et pleins de larmes. D’ailleurs est-ce bien l’œuvre d’une femme de soulever les tempêtes de l’orchestre et de faire mouvoir les chœurs ?
La musique des femmes n’a d’autres interprètes que la voix et le clavier ; elles prennent de la musique le parfum, la mélodie, elles respirent la fleur sur sa tige. Autrement, si elles veulent la cueillir, comme les hommes, leurs doigts délicats saignent bientôt. La Malibran trouvait dans ses loisirs de ravissantes inspirations, où serpentaient, comme des salamandres dans la flamme, les mille fantaisies de sa nature ardente. »
N’y aurait-il pas quelque inquiétude justifiée pour les hommes à voir des femmes compositrices se demande le critique dans Le Ménestrel du 20 novembre 1836 :
« Méfions-nous des femmes, messieurs, car tout à l’heure elles vont nous prouver qu’elles sont organisées comme nous, que la nature leur a départi un égal degré d’intelligence et de vigueur, qu’elles possèdent la même aptitude à briller dans les sciences et à cultiver les arts, en un mot qu’elles sont douées des mêmes facultés, capables des mêmes efforts, dignes des mêmes privilèges. Alors que deviendra notre amour propre, notre amour propre d’homme ? Et Dieu sait que nous en avons, race routinière ! vous accordez bien aux femmes la finesse et le talent de plaire, vous leur laissez les honneurs des beaux dévouements ; vous leur abandonnez l’empire de la grâce et du goût ; mais dès qu’elles font mine de dévier de l’étroit sentier que vous leur avez tracé, pour essayer leurs pas dans la grande route où s’agitent les hommes, voilà votre orgueil qui se gonfle, votre vanité qui se gendarme. Sexe présomptueux ! qui veux exploiter le monopole du génie, de la science et des affaires publiques, tu te crois seul intelligent, sensé, profond ; mais que deviendrais-tu si tu n’avais la femme pour t’aider de ses conseils , t’encourager d’un regard, te garantir contre mille pièges, et t’épargner la moitié des sottises que tu fais ! Il faut nous exécuter, messieurs : nous n’avons pas une ombre de faculté intellectuelle que la femme ne partage avec nous, et n’ait aussi bien que nous ; nous ne possédons pas une aptitude que la femme ne possède avec nous et tout aussi bien que nous ; un peu plus de force physique résume toute notre supériorité. Hors de là, rien. Chez la femme, le cœur est plus doux, le tact plus fin, les nerfs plus délicats, plus impressionnables. Voilà tout. Mais ce souffle divin qu’on nomme âme ou intelligence, qui descend du ciel et qui doit y remonter, se trouve répandu à égales doses dans l’une et l’autre organisation humaine. […]
La Esmeralda n’en est pas moins un ouvrage remarquable, sous le rapport de l’art, et digne de notre première scène ; la pièce est montée avec autant de soin que de goût, et Nourrit, Levasseur, Massol et Mlle Facon rivalisent de talent et d’intelligence dramatique. Tant que l’Opéra conservera ces artistes, la musique n’y périclitera pas. »
La critique s’est ensuite déchaînée contre Victor Hugo.
« Si l’auteur de ce poème était tout autre que l’auteur du roman de Notre-Dame de Paris, M. Victor Hugo serait en droit de lui demander compte de sa profanation. Dans ce cadre étroit, dans cette pâle copie, sans vie, sans mouvement, sans caractère, qui reconnaîtrait la vaste charpente et l’ardent coloris du tableau originel ? Que sont devenus tous ces incidents, toutes ces aventures qui se pressent, se croisent et s’accumulent, depuis le tournoi d’horribles grimaces dans la salle des Pas-Perdus, jusqu’à la chute de l’archidiacre du haut des tours sur le pavé ? Que sont devenus, tous ces personnages aux traits puissants, à l’expression hardie et profonde ? » (Louis Viardot, critique d’Esmeralda, Le Siècle, 18 novembre 1836).
« Avouons que le poète est pour quelque chose dans le magnifique ennui qui plane sur cette vaste conception. M. Victor Hugo a pris son roman, le plus admirable de ses romans, et sans pitié pour son sublime enfant, s’est amusé à le mutiler, à le dépecer, à le déchiqueter, à le démanteler, à le hacher-menu pour le service de la rue Lepelletier. Plus de cohésion, plus d’intérêt ! Rien ! » (Le Ménestrel, n°155, 20 novembre 1836)
« L’ouvrage de M. Hugo n’est point sans reproche pourtant ; il rythme bien, mais il rythme pour son compte, pour sa propre satisfaction, et non afin de servir son collaborateur. Il met souvent deux rimes dures de suite, ce qui rompt toute cadence ; il conclut sa phrase et la ferme par un point, avant que la phrase musicale ait pu être achevée. Il faut qu’une strophe de huit vers soit divisée en deux quatrains … » (Castil-Blaze)
Quant à Berlioz, qui a dirigé les répétitions à la place de Louise, incapable de le faire compte tenu de son handicap, il se voit attribuer la paternité des meilleurs morceaux !
« Comme il faut toujours que la malveillance intervienne, on a prétendu que cet air n’était pas de Mlle Bertin, mais d’un musicien dont le nom a jusqu’ici fait plus de bruit que l’œuvre qui n’est guère appréciée encore que d’un petit cercle d’amis dévoués. Étrange raisonnement, qui tombe de lui-même ! En effet, s’il arrivait, par fortune, au musicien dont nous parlons, de trouver une mélodie semblable, croyez bien qu’il ne serait pas si galant que d’en aller faire hommage à son prochain, fût-ce même à la fille du directeur du Journal des Débats. Il la garderait pour lui soigneusement, et n’aurait certes pas tort. » ( Henry Blaze de Bury)
Ce que Berlioz réfute expressément dans sa critique publiée à la Gazette musicale du 20 novembre 1836 :
« On a fait à fait à l’auteur de cet article l’honneur de lui attribuer la composition, ou, tout au moins, l’instrumentation de ce morceau. Un tel honneur, qu’il s’estimerait heureux de mériter, il le rend tout entier à mademoiselle Bertin, en protestant de la manière la plus formelle que pour ce bel air, comme pour tout le reste, elle seule l’a conçu, écrit et instrumenté ».
Et que réfute également le compositeur et critique musical Castil Blaze :
« Il n’est donc pas étonnant que Mlle Bertin ait composé un opéra et l’ait fait représenter sur la scène où tant d’autres musiciennes s’étaient déjà signalées. La science de la composition n’est point au-dessus de l’intelligence féminine. Il est vrai que la plupart des virtuoses de ce genre se bornent à trouver quelques mélodies gracieuses qu’elles livrent ensuite à un faiseur, qui les ajute et les polit. Mlle Bertin n’a jamais procédé de cette manière ; tout ce qu’elle a fait entendre est vraiment d’elle pour le fond et pour la forme ; je puis l’affirmer hautement, moi qui l’ai vue travailler, moi qui l’ai vue commencer, suivre et terminer plusieurs morceaux ; moi qui lui ai donné parfois les conseils qu’elle m’a demandés, et qu’elle n’a jamais suivis. Ce qu’il y a de surprenant, d’extraordinaire, c’est qu’elle ait choisi le style sérieux, tragique et se soit ainsi frayé une route dans un genre que les femmes avaient, jusqu’à ce jour, négligé pour de bonnes raisons. […] Chacun suit l’impulsion de son génie ; Mlle Bertin nous a montré dans Fausto, dans Esmeralda, qu’elle se sentait appelée à traiter les scènes les plus terribles et les plus fortement colorées du drame chanté. Elle n’est pas la seule, et parmi les virtuoses de la capitale, je puis citer deux femmes, que des études fortes et consciencieuses ont initiées aux mystères de l’harmonie et de la composition ; Mmes Louise Farrenc et Anna Molinos ne reculeraient certainement pas devant une tragédie lyrique en cinq actes. »
Mais il est évident que certains ont choisi d’atteindre la fille là où il ne pouvait atteindre le père :
« La Esmeralda de Mlle Louise Bertin est le troisième pas dans la carrière d’un talent jeune, mâle et progressif, qui, se sentant incomplet, s’éprouve et se corrige, et, depuis son début, a non seulement à lutter avec lui-même, mais encore avec cent haines que les autres ignorent, et que lui vaut sa position dans le monde. A ce titre seul, Mlle Louise Bertin mérite qu’on l’encourage et la relève. Il faut respecter qui travaille. Après tout, on ne croit guère en soit vainement, et si la note fatale ne chante point en vous, si l’inspiration ne vous sollicite, vous n’irez pas, de gaité de cœur, vous creuser la tête, et boire, après bien des traverses, le calice amer de la publicité, lorsqu’il ne tiendrait qu’à vous de vivre heureux et paisible, environné d’hommages et de soins, et de respirer à loisir, dans la famille, cette fleur de gloire qui n’a pas d’épines. La persévérance est fille de la conviction. Honneur à qui persévère ; je ne sache pas que la conviction fourmille tellement sur nos places et dans nos marchés littéraires, qu’on doive affecter de la maltraiter et de lui faire affront, lorsque, par hasard, elle se rencontre. […]
La Esmeralda est par le style et le caractère dominant, une œuvre cousine de Fausto. Il nous souvient encore de la première représentation de Fausto au Théâtre-Italien, des vieilles haines qui s’émurent à cette occasion, et de tous les amours-propres blessés à mort par le Journal des Débats, qui s’éveillèrent dans leurs sépulcres, revêtirent leurs armures rouillées pour entrer vaillamment en campagne, et venir s’abattre sur l’œuvre d’une jeune femme. Ce fut comme pour Esmeralda, un peu moins acharné peut-être, et rien en cela ne nous étonne ; Mlle Bertin devait bien s’y attendre. Plus la position est élevée, plus l’avenue en est gardée et l’abord difficile. Il est un moment où chaque degré de l’échelle dramatique enfante un obstacle nouveau. Pour peu qu’on ait une poignée d’ennemis en sortant de l’Opéra Comique, on est sûr d’avoir contre soi la multitude en arrivant à l’Opéra. Si Mlle Bertin voulait renfermer sa pensée dans les justes limites d’un petit acte, et se résigner à n’écrire que ballades, romances, cantatilles, villanelles et sornettes à l’usage de Mme Dorus, on la laisserait faire et triompher à son aise. » (Henry Blaze de Bury)
« Mais tous ces brillants accessoires ne doivent pas nous distraire plus longtemps de l’objet principal, la musique, dont a tant parlé sans la connaître, et dont le mérite ne peut manquer d’être reconnue avant peu de tous les gens doués de quelque sentiment élevé de l’art et de la moindre impartialité. Pour ceux qui ont fait leur siège d’avance, comme des passions politiques des haines de parti leur dictent seules leur jugement, nous n’essaierons pas de les combattre ; l’art ne peut ni ne doit rien avoir à démêler avec de pareilles questions. » (Berlioz)
Sources : Florence Launay, Les compositrices en France au XIXe siècle, Fayard. Arnaud et Lise Régner, La réception de La Esmeralda comme révélateur de sa modernité, Colloques de l’Opéra Comique, La modernité française au temps de Berlioz, février 2010. Henry Blaze de Bury, « De la musique des femmes. Mlle Louise Bertin », Revue des deux mondes, 1836, n°4, p. 611-625. Castil-Blaze, “La Esmeralda, musique de Mlle Bertin », Revue de Paris, t. XXXV, 1836, p. 212-218.
Sources visuelles : wikicommons
Pour écouter La Esmeralda : ici.


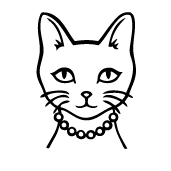










 Prédiction réalisée. – Louis dit un jour à Philippe, son frère : « Vous épouserez la princesse d’Angleterre parce que personne n’en veut. M. de Savoie l’a refusée. J’en ai fait parler à M. de Florence, où l’on en veut point : c’est pourquoi je conclus que vous l’aurez ! ».
Prédiction réalisée. – Louis dit un jour à Philippe, son frère : « Vous épouserez la princesse d’Angleterre parce que personne n’en veut. M. de Savoie l’a refusée. J’en ai fait parler à M. de Florence, où l’on en veut point : c’est pourquoi je conclus que vous l’aurez ! ».






