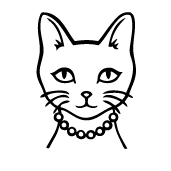Isidore Ducasse – le comte de Lautréamont – est mort le 24 novembre 1870.

Isidore Ducasse
Résumé. – Isidore Ducasse est une “météorite” de la littérature française. Né en 1846 à Montevideo (Uruguay), installé à Paris en 1868, il publie sous le pseudonyme du Comte de Lautréamont, Les Chants de Maldoror et sous son vrai nom, Poésies I et II, deux ans plus tard, quelques mois avant de mourir au cours du siège de Paris, à peine âgé de 24 ans. Depuis, les Chants de Maldoror sont devenus un ouvrage mythique, indispensable dans toute bibliothèque et dans “Le Monde de Soracha“.
Jeunesse. – Isidore Ducasse est né le 4 avril 1846 à Montevideo en Uruguay. Son père, François Ducasse, instituteur dans la région de Bigorre, a émigré en Amérique du sud où il est devenu chancelier à la légation de France. Sa mère, Céleste Ducasse, meurt quelques semaines après l’accouchement. Le jeune Isidore passe une grande partie de sa jeunesse – et donc de sa vie – en Uruguay avant d’arriver en France vers 1859 où, interne au lycée impérial de Tarbes, il est un bon élève. Entré au lycée impérial de Pau pour poursuivre ses études toujours comme interne, il obtient son baccalauréat ès lettres en 1863.
« Philosophe incompréhensibiliste ». – Ainsi se définit le jeune Isidore au cours de ses études. qui, après un retour à Montevideo en 1867, revient s’installer à Paris, capitale littéraire du monde, pour devenir un auteur. « Ainsi donc, ce que je désire avant tout, c’est être jugé par la critique, et, une fois connu, ça ira tout seul » (Lettre de Ducasse à Auguste Poulet-Malassis du 23 octobre 1869). Subventionné par son père, Ducasse publie en août 1868 de manière anonyme le Chant Premier des Chants de Maldoror chez Balitout, Questroy et Cie.
« Plût au ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu’il lit, trouve, sans se désorienter, son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison ; car à moins qu’il n’apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d’esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l’eau le sucre. Il n’est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre ; quelques-uns seuls savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. » (Chant I, 1).
Le 10 novembre 1868, Ducasse envoie une lettre à Victor Hugo – qualifié « de Funèbre-Echalas-Vert» dans Poésies I – dans laquelle il lui demande de lui écrire une lettre, ce qui l’aiderait à être imprimé par M. Lacroix, l’imprimeur d’Hugo. Il termine ainsi sa lettre :
«Vous ne sauriez croire combien vous rendriez un être humain heureux, si vous m’écriviez quelques mots. Me promettez-vous en outre un exemplaire de chacun des ouvrages que vous allez faire paraître au mois de janvier ? Et maintenant, parvenu à la fin de ma lettre, je regarde mon audace avec plus de sang-froid, et je frémis de vous avoir écrit, moi qui ne suis encore rien dans ce siècle, tandis que vous, vous y êtes le Tout».
Une seule critique, signée « Epistémon » est publiée, dans La Jeunesse, une revue d’étudiants du Quartier Latin, par Christian Calmeau que Ducasse connaissait probablement :
« Le premier effet produit par la lecture de ce livre est l’étonnement : l’emphase hyperbolique du style, l’étrangeté sauvage, la vigueur désespérée d’idées, le contraste de ce langage passionné avec les plus fades élucubrations de notre temps, jettent d’abord l’esprit dans une stupeur profonde. [ …] Nous ne pousserons pas plus loin l’examen de ce livre. Il faut le lire pour sentir l’inspiration puissante qui l’anime, le désespoir sombre répandu dans ces pages lugubres. Malgré ses défauts, qui sont nombreux, l’incorrection du style, la confusion des tableaux, cet ouvrage, nous le croyons, ne passera pas confondu avec les autres publications du jour : son originalité peu commune nous est garante.»

Lautréamont imaginé par Félix Vallotton.
Un « écrivain maudit». – Les six chants sont publiés en 1869 à Bruxelles par Lacroix et Verboeckhoven avec comme nom d’auteur «le comte de Lautréamont », pseudonyme sans doute inspiré du Latréaumont d’Eugène Sue, personnage historique, chef d’une conjuration contre Louis XIV.
Lacroix refuse toutefois de vendre le livre en France : « dans le courant de 1869, M. le comte de Lautréamont venait de délivrer les dernier bons à tirer de son livre, et celui-ci allait être broché, lorsque l’éditeur – continuellement en butte aux persécutions de l’Empire – en suspendit la mise en vente à cause de certaines violences de style qui en rendaient la publication périlleuse. » (Genonceaux)
L’éditeur français des Fleurs du Mal, Auguste Poulet-Malassis, est mis à contribution par Ducasse pour publier l’annonce suivante pour essayer de faire vendre l’ouvrage : « il n’y a plus de manichéens, disait Panglos. – Il y a moi », répondait Martin. L’auteur de ce livre n’est pas d’une espèce moins rare. Comme Baudelaire, comme Flaubert, il croit que l’expression esthétique du mal implique la plus vive appétition du bien, la plus haute moralité. M. Isidore Ducasse (nous avons eu la curiosité de connaître son nom » a eu tort de ne pas faire imprimer en France Les Chants de Maldoror. Le sacrement de la sixième chambre ne lui eût pas manqué. » En Vain.

Narcisse Chaillou, Le dépeceur de rats.
1870. – Ducasse publie sous son nom deux fascicules en prose intitulés Poésies I et II; aucune critique n’en parle. La guerre franco-prussienne éclate en juillet ; Paris est assiégée en septembre. Chat, chien, corbeaux, brochettes de moineaux sont vendus aux Parisiens, ainsi que les animaux du zoo du jardin d’acclimatation. Un marché aux rats s’organise sur la place de l’Hôtel de ville : les rats sont vendus entre 10 et 15 sous. La variole et la fièvre typhoïde déciment la population. Le 24 novembre, Isidore Ducasse, âgé de 24 ans, est trouvé mort dans sa chambre du 7, rue du Faubourg Montmartre : « le comte de Lautréamont s’est éteint, emporté en deux jours par une fièvre maligne. » (Genonceaux), « la seule gloire vraiment noble de nos temps. » (Villiers de L’Isle-Adam).
Naissance d’un mythe. – Une vie brisée, pas de manuscrits, peu de témoins, tel est l’auteur. Un ouvrage n’appartenant à aucun genre littéraire, inconnu du public du vivant de l’auteur, tel est cet « ouvrage singulièrement moderne » pour reprendre l’expression de Jean-Jacques Lefrère.
« Ce volume, imprimé à Bruxelles, a été, nous assure-t-on, tiré à petit nombre et supprimé ensuite par l’auteur qui a dissimulé son véritable nom sous pseudonyme. Il tiendra une place parmi les singularité bibliographiques ; point de préface, une série de visions et de réflexions en style bizarre, une espèce d’Apocalypse dont il serait fort inutile de chercher à devenir le sens. Est-ce une gageure ? L’écrivain a l’air fort sérieux, et rien n’est plus lugubre que les tableaux qu’il place sous les yeux de ses lecteurs. » (Charles Asselineau,1870).
Quelques écrivains, contemporains de Ducasse ou nés quelques années plus tard, ont lu Les Chants de Maldoror et Poésies et ont été frappés par l’œuvre :
« La critique appréciera, comme il convient, Les Chants de Maldoror, poème étrange et inégal où, dans un désordre furieux, se heurtent des épisodes admirables et d’autres souvent confus. […] Si Ducasse avait vécu, il eût pu devenir l’une des gloires littéraires de la France. Il est mort trop tôt, laissant derrière lui son œuvre éparpillée aux quatre vents ; et par une coïncidence curieuse, ses restes mortels ont subi le même sort que son livre » (Genonceaux, 1890).
« Ce fut un magnifique coup de génie, presque inexplicable. Unique, ce livre le demeurera, et dès maintenant il reste acquis à la liste des œuvres qui, à l’exclusion de tout classicisme, forment la brève bibliothèque et la seule littérature admissibles pour ceux sont l’esprit, mal fait, se refuse aux joies, moins rares, du lieu commun et de la morale conventionnelle. » (Rémy de Gourmont, 1891).
« Les Chants de Maldoror sont un de nos petits classiques. Peu importe que le grand public les ignore et que les manuels ne les mentionnent pas encore (cela viendra). » (Valéry Larbaud, 1914).
Mais il n’y a pas que les écrivains qui le connaissent. Fasciné par Les Chants de Maldoror qu’il fait découvrir à son amie la poétesse Anna Akhmatova ainsi qu’au collectionneur Paul Alexandre, Modigliani se fait renvoyer en Italie, lors de son séjour à Livourne en 1913, son édition personnelle qu’il a oubliée à Paris.
Mais ce sont les surréalistes – Soupault, Aragon, Breton – qui vont faire découvrir l’œuvre de Ducasse : « le plus beau titre de gloire du groupe qu’ont formé Breton, Aragon et Soupault, est d’avoir reconnu et proclamé l’importance littéraire et ultra littéraire de l’admirable Lautréamont. » (André Gide, 1925). « Plus les rapports des deux réalités rapprochées seront lointains et justes, plus l’image sera forte – plus elle aura de réalité poétique « (Breton, Manifeste du surréalisme, 1924). « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à coudre et d’un parapluie ! » (VI, 1) devient une phrase-clé du surréalisme : « les beau comme de Lautréamont constituent le manifeste même de la poésie convulsive (Breton, L’Amour fou, 1937).

Victor Hugo, La pieuvre. Vers 1866
Bestiaire de Lautréamont. – « Frappé de cette énorme production biologique, de cette confiance inouïe dans l’acte animal, nous avons entrepris une étude systématique du Bestiaire de Lautréamont. En particulier, nous avons essayé de reconnaître les animaux les plus fortement valorisés, les fonctions animales les plus nettement désirées par Lautréamont. Une statistique rapide donne, parmi les 185 animaux du bestiaire ducassien, les premiers rangs au chien, au cheval, au crabe, à l’araignée, au crapaud. » (Gaston Bachelard).
Lautréamont, poète animalier ? Selon Jean-Pierre Lassalle, il y aurait « seulement » 177 animaux dans Les Chants de Maldoror et 2 dans Poésies I et II, soit 179. Assurément plus que dans les Fables de Jean de La Fontaine. Mais, contrairement au poète du XVIIe siècle, Lautréamont « ne se sert pas d’animaux pour instruire les hommes » ! Même si plusieurs descriptions d’animaux sont plagiées de l’Encyclopédie d’Histoire Naturelle du Dr Chenu, lequel avait compilé des textes de Buffon et de son collaborateur Guéneau de Monbeillard …
Cher lecteur, honneur à mes amis Pompona et Le Rat.Voici d’abord les extraits concernant « le chat » :
« soit comme un chat blessé au vent au-dessus d’un toit » (I, 8) ; « gracieuse comme un jeune chat » (III, 2) ; « quand un rôdeur de barrières […] aperçoit un vieux chat musculeux, contemporain des révolutions auxquelles ont assisté nos pères […]. Le noble animal de la race féline attend son adversaire avec courage, et dispute chèrement sa vie. Demain quelque chiffonnier achètera une peau électrisable. Que ne fuyait-il donc ? C’était si facile » (VI, I) ; « depuis le jour où un chat angora me rongea, pendant une heure, la bosse pariétale, comme un trépan qui perfore le crâne, en s’élançant brusquement sur mon dos, parce que j’avais fait bouillir ses petits dans une cuve remplie d’alcool, … » (VI, IV)
Et maintenant les extraits concernant « le rat » :
« contre les chouettes, dont le vol oblique leur rase le museau, emportant un rat ou une grenouille dans le bec, nourriture vivante, douce pour les petits » (I, 8) ; « et quoi, n’est-on pas parvenu à greffer sur le dos d’un rat vivant la queue détachée du corps d’un autre rat ? » (V, 1) ; « beau […] comme ce piège à rats perpétuel, toujours retendu par l’animal pris, qui peut prendre seul des rongeurs indéfiniment, et fonctionner même caché sous la paille » (VI, I).
« On doit une grande reconnaissance à M. Gaston Bachelard pour l’accent qu’il a mis (le premier à ma connaissance) sur le caractère extraordinairement agressif des monstres qui peuplent Les Chants de Maldoror. C’est vraiment un règne, animal, pourvu cette fois de souffle vital, qui s’agite ici, d’une animalité conquérante et avide, toujours prête à étendre symboliquement la griffe. » (Julien Gracq, 1946)
« Comment juger ? Que dire, qu’écrire des Chants de Maldoror? Fut-il entrer dans le jeu des adultes, et chercher de nouveaux aliments pour satisfaire cette hideuse envie de comprendre ? Faut-il annexe ceci, ou rejeter cela ? Faut-il parler de révolte, de passion de l’absolu, de lutte contre Dieu, ou contre le père, d’obsession, de délire, de liberté, de recherche du bien par les voies du mal ? Faut-il analyser chaque Chant mot par mot, faut-il essayer de déchiffrer le mouvement des images, faut-il dresser une liste de fréquence du vocabulaire, établir la carte du microcosme ? Faut-il parler de griffes et de crocs, de création autonome, d’hallucinations belladonées, de schizophrénie ? » (J. M. G. Le Clézio, 1967).
Le mieux n’est-il pas de le lire ?
« Quelle est cette armée de monstres marins qui fend les flots avec vitesse ? Ils sont six ; leurs nageoires sont vigoureuses, et s’ouvrent un passage, à travers les vagues soulevées. De tous ces êtres humains, qui remuent les quatre membres dans ce continent peu ferme, les requins ne font bientôt qu’une omelette sans œufs, et se la partagent d’après la loi du plus fort. Le sang se mêle aux eaux, et les eaux se mêlent au sang. Leurs yeux féroces éclairent suffisamment la scène du carnage … Mais, quel est encore ce tumulte des eaux, là-bas, à l’horizon ? On dirait une trombe qui s’approche. Quels coups de rame ! J’aperçois ce que c’est. Une énorme femelle de requin vient prendre part au pâté de foie de canard, et manger du bouilli froid. Elle est furieuse, car elle arrive affamée. Une lutte s’engage entre elle et les requins, pour se disputer les quelques membres palpitants qui flottent par-ci, par-là, sans rien dire, sur la surface de la crème rouge. A droite, à gauche, elle lance des coups de dent qui engendrent des blessures mortelles. Mais, trois requins vivants l’entourent encore, et elle est obligée de tourner en tous sens, pour déjouer leurs manœuvres. Avec une émotion croissante, inconnue jusqu’alors, le spectateur, placé sur le rivage, suit cette bataille navale d’un nouveau genre. Il a les yeux fixés sur cette courageuse femelle de requin, aux dents si fortes. Il n’hésite plus, il épaule son fusil, et, avec son adresse habituelle, il loge sa deuxième balle dans l’ouïe d’un des requins, au moment où il se montrait au-dessus d’une vague. Restent deux requins qui n’en témoignent qu’un acharnement plus grand. Du haut du rocher, l’homme à la salive saumâtre, se jette à la mer, et nage vers le tapis agréablement coloré, en tenant à la main ce couteau d’acier qui ne l’abandonne jamais. Désormais, chaque requin a affaire à un ennemi. Il s’avance vers son adversaire fatigué, et, prenant son temps, lui enfonce dans le ventre sa lame aiguë. La citadelle mobile se débarrasse facilement du dernier adversaire … Se trouvent en présence le nageur et la femelle de requin, sauvée par lui. Ils se regardèrent entre les yeux pendant quelques minutes ; et chacun s’étonna de trouver tant de férocité dans les regards de l’autre. Ils tournent en rond en nageant, ne se perdent pas de vue, et se disent à part soi : « je me suis trompé jusqu’ici ; en voilà un qui est plus méchant ». Alors, d’un commun accord, entre deux eaux, ils glissèrent l’un vers l’autre, avec une admiration mutuelle, la femelle du requin écartant l’eau de ses nageoires, Maldoror battant l’onde avec ses bras ; et retinrent leur souffle, dans une vénération profonde, chacun désireux de contempler, pour la première fois, son portrait vivant. Arrivés à trois mètres de distance, sans faire aucun effort, ils tombèrent brusquement l’un contre l’autre, comme deux aimants, et s’embrassèrent avec dignité et reconnaissance, dans une étreinte aussi tendre que celle d’un frère ou d’une sœur. Les désirs charnels suivirent de près cette démonstration d’amitié. Deux cuisses nerveuses se collèrent étroitement à la peau visqueuse du monstre, comme deus sangsues ; et, les bras et les nageoires entrelacés autour du corps de l’objet aimé qu’ils entouraient avec amour, tandis que leurs gorges et leurs poitrines ne faisaient bientôt plus qu’une masse glauque aux exhalaisons de goémon ; au milieu de la tempête qui continuait de sévir ; à la lueur des éclairs ; ayant pour lit d’hyménée la vague écumeuse, emportés par un courant sous-marin comme dans un berceau, et roulant, sur eux-mêmes, vers les profondeurs inconnues de l’abîme, ils se réunirent dans un accouplement long, chaste et hideux ! … Enfin, je venais de trouver quelqu’un qui me ressemblât !… Désormais je n’étais plus seul dans la vie !… Elle avait les mêmes idées que moi !… J’étais en face de mon premier amour !… » (Chant II, 13).
« Ouvrez Lautréamont ! Et voilà toute la littérature retournée comme un parapluie !
Fermez Lautréamont ! Et tout, aussitôt, se remet en place … » (Francis Ponge, 1946)
Sources : ouvrages : Lautréamont, Oeuvres complètes, Gallimard, La pléiade; Jean-Jacques Lefrère, Lautréamont, Flammarion. Articles : Jean-Pierre Lassalle, « Le bestiaire de Lautréamont, classement commenté des animaux », Anthropozoologica, 42(1) : 7-18; Alain Trouvé, « de Maldoror aux Poésies. Extravagance et défi de lecture ». Sites consultés : les essentiels de la BNF : auteur et jugements critiques; les cahiers de Lautréamont.
Sources visuelles : wikicommons : Isidore Ducasse, Photo-carte de visite, exécutée à Tarbes en 1867 par le studio Blanchard, place Maubourguet. Ce document a été retrouvé par Jean-Jacques Lefrère à Bagnères-de-Bigorre en 1977 chez des descendants de la famille de Georges Dazet (1852-1920), fils de Jean Dazet, le tuteur de Ducasse ; Félix Vallotton, Portrait du Comte de Lautréamont, in Le Livre des masques (vol. II, 1898), par Remy de Gourmont (1858-1916). histoire-image.org : Narcisse Chaillou, Le dépeceur de rats. BNF.fr : Victor Hugo, la pieuvre.




 Prédiction réalisée. – Louis dit un jour à Philippe, son frère : « Vous épouserez la princesse d’Angleterre parce que personne n’en veut. M. de Savoie l’a refusée. J’en ai fait parler à M. de Florence, où l’on en veut point : c’est pourquoi je conclus que vous l’aurez ! ».
Prédiction réalisée. – Louis dit un jour à Philippe, son frère : « Vous épouserez la princesse d’Angleterre parce que personne n’en veut. M. de Savoie l’a refusée. J’en ai fait parler à M. de Florence, où l’on en veut point : c’est pourquoi je conclus que vous l’aurez ! ».