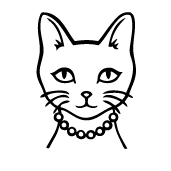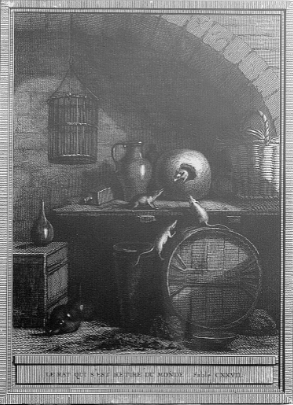Le 3 février 1468, Johannes Gensfleich zur Laden zum Gutenberg – dit Gutenberg -, inventeur de génie, est décédé à Mayence.

Né à Mayence vers 1400, Gutenberg s’est installé en 1434 à Strasbourg où il a fait son apprentissage dans l’orfèvrerie. Il travaille les métaux – alliages, ciselures – et la taille des pierres précieuses.
Gutenberg cherche à reproduire plus rapidement et en plus grand nombre les manuscrits médiévaux – appelés codex – réalisés par les moines copistes. Il crée des caractères mobiles en métal, formé d’un alliage de plomb, d’antimoine et d’étain, qui s’apparentent à l’écriture gothique utilisée par les moines.
Gutenberg cherche à reproduire plus rapidement et en plus grand nombre les manuscrits médiévaux – appelés codex – réalisés par les moines copistes. Il crée des caractères mobiles en métal, formé d’un alliage de plomb, d’antimoine et d’étain, qui s’apparentent à l’écriture gothique utilisée par les moines.