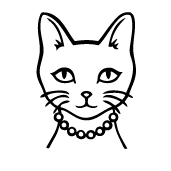La laitière et le pot au lait
Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait
Bien posé sur un coussinet,
Prétendait arriver sans encombre à la ville.
Légère et court vêtue, elle allait à grands pas,
Ayant mis ce jour-là pour être plus agile
Cotillon simple, et souliers plats.
Notre laitière ainsi troussée
Comptait déjà dans sa pensée
Tout le prix de son lait, en employait l’argent,
Achetait un cent d’oeufs, faisait triple couvée;
La chose allait à bien par son soin diligent.
“Il m’est, disait-elle, facile
D’élever des poulets autour de ma maison;
Le renard sera bien habile,
S’il ne m’en laisse assez pour avoir un cochon.
Le porc à s’engraisser coûtera peu de son;
Il était, quand je l’eus, de grosseur raisonnable;
J’aurai, le revendant, de l’argent bel et bon.
Et qui m’empêchera de mettre en notre étable,
Vu le prix dont il est, une vache et son veau,
Que je verrai sauter au milieu du troupeau?”
Perrette, là-dessus saute aussi, transportée.
Le lait tombe: adieu veau, vache, cochon, couvée.
La dame de ces biens, quittant d’un oeil marri
Sa fortune ainsi répandue,
Va s’excuser à son mari.
En grand danger d’être battue.
Le récit en farce en fut fait:
On l’appela le Pot au lait.
Quel esprit ne bat la campagne?
Qui ne fait châteaux en Espagne?
Picrochole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous,
Autant les sages que les fous?
Chacun songe en veillant, il n’est rien de plus doux;
Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes:
Tout le bien du monde est à nous,
Tous les honneurs, toutes les femmes.
Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi:
Je m’écarte, je vais détrôner le sophi;
On m’élit roi, mon peuple m’aime;
Les diadèmes vont sur ma tête pleuvant.
Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même,
Je suis Gros-Jean comme devant.
Jean de La Fontaine Livre VII, fable 10

La laitière et le pot au lait. J.-B. Oudry Source: Gallica.bnf.fr/BnF

A la Malibran – Alfred de Musset
Stances
I.
Sans doute il est trop tard pour parler encor d’elle;
Depuis qu’elle n’est plus quinze jours sont passés,
Et dans ce pays-ci quinze jours, je le sais,
Font d’une mort récente une vieille nouvelle.
De quelque nom d’ailleurs que le regret s’appelle,
L’homme, par tous pays, en a bien vite assez.
II.
O Maria-Félicia ! le peintre et le poète
Laissent, en expirant, d’immortels héritiers;
Jamais l’affreuse nuit ne les prend tout entiers.
A défaut d’action, leur grande âme inquiète
De la mort et du temps entreprend la conquête,
Et, frappés dans la lutte, ils tombent en guerriers.
III.
Celui-là sur l’airain a gravé sa pensée;
Dans un rythme doré l’autre l’a cadencée;
Du moment qu’on l’écoute, on lui devient ami.
Sur sa toile, en mourant, Raphaël l’a laissée,
Et, pour que le néant ne touche point à lui,
C’est assez d’un enfant sur sa mère endormi.
IV.
Comme dans une lampe une flamme fidèle,
Au fond du Parthénon le marbre inhabité
Garde de Phidias la mémoire éternelle,
Et la jeune Vénus, fille de Praxitèle,
Sourit encor, debout dans sa divinité,
Aux siècles impuissants qu’a vaincus sa beauté.
V.
Recevant d’âge en âge une nouvelle vie,
Ainsi s’en vont à Dieu les gloires d’autrefois;
Ainsi le vaste écho de la voix du génie
Devient du genre humain l’universelle voix…
Et de toi, morte hier, de toi, pauvre Marie,
Au fond d’une chapelle il nous reste une croix!
VI.
Une croix! et l’oubli, la nuit et le silence!
Ecoutez! c’est le vent, c’est l’Océan immense;
C’est un pêcheur qui chante au bord du grand chemin,
Et de tant de beauté, de gloire et d’espérance,
De tant d’accords si doux d’un instrument divin,
Pas un faible soupir, pas un écho lointain!
VII.
Une croix! et ton nom écrit sur une pierre,
Non pas même le tien, mais celui d’un époux,
Voilà ce qu’après toi tu laisses sur la terre;
Et ceux qui t’iront voir à ta maison dernière,
N’y trouvant pas ce nom qui fut aimé de nous,
Ne sauront pour prier où poser les genoux.
VIII.
O Ninette! où sont-ils, belle muse adorée,
Ces accents pleins d’amour, de charme et de terreur,
Qui voltigeaient le soir sur ta lèvre inspirée,
Comme un parfum léger sur l’aubépine en fleur?
Où vibre maintenant cette voix éplorée,
Cette harpe vivante attachée à ton coeur?
IX.
N’étais-ce pas hier, fille joyeuse et folle,
Que ta verve railleuse animait Corilla,
Et que tu nous lançais avec la Rosina
La roulade amoureuse et l’oeillade espagnole?
Ces pleurs sur tes bras nus, quand tu chantais le Saule,
N’était-ce pas hier, pâle Desdemona?
X.
N’étais-ce pas hier qu’à la fleur de ton âge
Tu traversais l’Europe, une lyre à la main;
Dans la mer, en riant, te jetant à la nage,
Chantant la tarentelle au ciel napolitain,
Coeur d’ange et de lion, libre oiseau de passage,
Espiègle enfant ce soir, sainte artiste demain?
XI.
N’étais-ce pas hier qu’enivrée et bénie
Tu traînais à ton char un peuple transporté,
Et que Londre et Madrid, la France et l’Italie,
apportaient à tes pieds cet or tant convoité,
Cet or deux fois sacré qui payait ton génie,
Et qu’à tes pieds souvent laissa ta charité?
XII.
Qu’as-tu fait pour mourir, ô noble créature,
Belle image de Dieu, qui donnais en chemin
Au riche un peu de joie, au malheureux du pain?
Ah! qui donc frappe ainsi dans la mère nature,
Et quel faucheur aveugle, affamé de pâture,
Sur les meilleurs de nous ose porter la main?
XIII.
Ne suffit-il donc pas à l’ange de ténèbres
Qu’à peine de ce temps il nous reste un grand nom?
Que Géricault, Cuvier, Schiller, Goethe et Byron
Soient endormis d’hier sous les dalles funèbres,
Et que nous ayons vu tant d’autres morts célèbres
Dans l’abîme entr’ouvert suivre Napoléon?
XIV.
Nous faut-il perdre encor nos têtes les plus chères,
Et venir en pleurant leur fermer les paupières,
Dès qu’un rayon d’espoir a brillé dans leurs yeux?
Le ciel de ses élus devient-il envieux?
Ou faut-il croire, hélais! ce que disaient nos pères,
Que lorsqu’on meurt si jeune on est aimé des dieux?
XV.
Ah! combien, depuis peu, sont partis pleins de vie!
Sous les cyprès anciens que de saules nouveaux!
La cendre de Robert à peine refroidie,
Bellini tombe et meurt! – Une lente agonie
Trâine Carrel sanglant à l’éternel repos.
Le seuil de notre siècle est pavé de tombeaux.
XVI.
Que nous restera-t-il si l’ombre insatiable,
Dès que nous bâtissons, vient tout ensevelir?
Nous qui sentons déjà le sol si variable,
Et, sur tant de débris, marchons vers l’avenir,
Si le vent, sous nos pas, balaye ainsi le sable,
De quel deuil le Seigneur veut-il donc nous vêtir?
XVII.
Hélas! Marietta, tu nous restais encore.
Lorsque sur le sillon, l’oiseau chante à l’aurore,
Le laboureur s’arrête, et, le front en sueur,
Apspire dans l’air pur un souffle de bonheur.
Ainsi nous consolait ta voix fraîche et sonore,
Et tes chants dans les cieux emportaient la douleur.
XVIII.
Ce qu’il nous faut pleurer sur ta tombe hâtive,
Ce n’est pas l’art divin, ni ses savants secrets;
Quelque autre étudiera cet art que tu créais;
C’est ton âme, Ninette, et ta grandeur naïve,
C’est cette voix du cœur qui seule au cœur arrive,
Que nul autre, après toi, ne nous rendra jamais.
XIX.
Ah! tu vivrais encor sans cette âme indomptable.
Ce fut là ton seul mal, et le secret fardeau
Sous lequel ton beau corps plia comme un roseau.
Il en soutint longtemps la lutte inexorable.
C’est le Dieu tout-puissant, c’est la Muse implacable
Qui dans ses bras en feu t’a portée au tombeau.
XX.
Que ne l’étouffais-tu, cette flamme brûlante
Que ton sein palpitant ne pouvait contenir!
Tu vivrais, tu verrais te suivre et t’applaudir
De ce public blasé la foule indifférente,
Qui prodigue aujourd’hui sa faveur inconstante
A des gens dont pas un, certes, n’en doit mourir.
XXI.
Connaissais-tu si peu l’ingratitude humaine?
Quel rêve as-tu donc fait de te tuer pour eux?
Quelques bouquets de fleurs te rendaient-ils si vaine,
Pour venir nous verser de vrais pleurs sur la scène,
Lorsque tant d’histrions et d’artistes fameux,
Couronnés mille fois, n’en ont pas dans les yeux?
XXII.
Que ne détournais-tu la tête pour sourire,
Comme on en use ici quand on feint d’être ému?
Hélas! on t’aimait tant, qu’on n’en aurait rien vu.
Quand tu chantais le Saule, au lieu de ce délire,
Que ne t’occupais-tu de bien porter ta lyre?
La Pasta fait ainsi : que ne l’imitais-tu?
XXIII.
Ne savais-tu donc pas, comédienne imprudente,
Que ces cris insensés qui te sortaient du cœur
De ta joue amaigrie augmentaient la pâleur?
Ne savais-tu donc pas que, sur ta tempe ardente,
Ta main de jour en jour se posait plus tremblante,
Et que c’est tenter Dieu que d’aimer la douleur?
XXIV.
Ne sentais-tu donc pas que ta belle jeunesse
De tes yeux fatigués s’écoulait en ruisseaux,
Et de ton noble cœur s’exhalait en sanglots?
Quand de ceux qui t’aimaient tu voyais la tristesse,
Ne sentais-tu donc pas qu’une fatale ivresse
Berçait ta vie errante à ses derniers rameaux?
XXV.
Oui, oui, tu le savais, qu’au sortir du théâtre,
Un soir dans ton linceul il faudrait te coucher.
Lorsqu’on te rapportait plus froide que l’albâtre,
Lorsque le médecin, de ta veine bleuâtre,
Regardait goutte à goutte un sang noir s’épancher,
Tu savais quelle main venait de te toucher.
XXVI.
Oui, oui, tu le savais, et que, dans cette vie,
Rien n’est bon que d’aimer, n’est vrai que de souffrir.
Chaque soir dans tes chants tu te sentais pâlir.
Tu connaissais le monde, et la foule, et l’envie,
Et, dans ce corps brisé concentrant ton génie,
Tu regardais aussi la Malibran mourir.
Alfred de Musset (1810 – 1857)
Stances publiées dans la Revue des deux mondes le 15 octobre 1836.

Le lièvre et les grenouilles
Un lièvre en son gîte songeait
(Car que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe?);
Dans un profond ennui ce lièvre se plongeait:
Cet animal est triste, et la crainte le ronge.
“Les gens de naturel peureux
Sont, disait-il, bien malheureux;
Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite.
Jamais un plaisir pur, toujours assauts divers.
Voilà comme je vis; cette crainte maudite
M’empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle,
Et la peur se corrige-t-elle?
Je crois même qu’en bonne foi
Les hommes ont peur comme moi.”
Ainsi raisonnait notre lièvre,
Et cependant faisait le guet.
Il était douteux, inquiet:
Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.
Le mélancolique animal,
En rêvant à cette matière,
Entend un léger bruit: ce lui fut un signal
Pour s’enfuir devers sa tanière.
Il s’en alla passer sur le bord d’un étang.
Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes;
Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.
“Oh! dit-il, j’en fais faire autant
Qu’on m’en fait faire! Ma présence
Effraye aussi les gens, je mets l’alarme au camp!
Comment! des animaux qui tremblent devant moi!
Je suis donc un foudre de guerre?
Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre
Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.”
Jean de La Fontaine Livre II, fable 14

Le lièvre et les grenouilles. J.-B. Oudry. Source : Gallica.bnf.fr/BnF
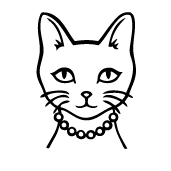
Les oreilles du lièvre
Un animal cornu blessa de quelques coups
Le lion, qui plein de courroux,
Pour ne plus tomber en la peine,
Bannit des lieux de son domaine
Toute bête portant des cornes à son front.
Chèvres, béliers, taureaux, aussitôt délogèrent,
Daims et cerfs de climat changèrent:
Chacun à s’en aller fut prompt.
Un lièvre, apercevant l’ombre de ses oreilles,
Craignit que quelque inquisiteur
N’allât interpréter à cornes leur longueur,
Ne les soutînt en tout à des cornes pareilles.
“Adieu, voisin grillon, dit-il, je pars d’ici;
Mes oreilles enfin seraient cornes aussi;
Et quand je les aurais plus courtes qu’une autruche,
Je craindrais même encor.” Le grillon repartit:
“Cornes cela? Vous me prenez pour cruche;
Ce son oreilles que Dieu fit.
On les fera passer pour cornes,
Dit l’animal craintif, et cornes de licornes.
J’aurai beau protester; mon dire et mes raisons
Iront aux Petites-Maisons.”
Jean de La Fontaine Livre V, fable 4

Les oreilles du lièvre. J.-B. Oudry. Source : gallica.bnf.fr/BnF

Le lièvre et la perdrix
Il ne faut jamais moquer des misérables :
Car qui peut s’assurer d’être toujours heureux?
Le sage Ésope dans ses fables
Nous en donne un exemple ou deux.
Celui qu’en ces vers je propose,
Et les siens, ce sont même chose.
Le lièvre et la perdrix, concitoyens d’un champ,
Vivaient dans un état, ce semble, assez tranquille,
Quand une meute s’approchant
Oblige le premier à chercher un asile.
Il s’enfuit dans son fort, met les chiens en défaut,
Sans même en excepter Brifaut.
Enfin il se trahit lui-même
Par les esprits sortant de son corps échauffé.
Miraut, sur leur odeur ayant philosophé,
Conclut que c’est son lièvre, et d’une ardeur extrême
Il le pousse, et Rustaut, qui n’a jamais menti,
Dit que le lièvre est reparti.
Le pauvre malheureux vient mourir à son gîte.
La perdrix le raille, et lui dit:
“Tu te vantais d’être si vite:
Qu’as-tu fait de tes pieds?” Au moment qu’elle rit,
Son tour vient; on la trouve. Elle croit que ses ailes
La sauront garantir à toute extrémité;
Mais la pauvrette avait compté
Sans l’autour aux serres cruelles.
Jean de La Fontaine Livre V, fable 17

Le lièvre et la perdrix. J.-B. Oudry. Source : gallica.bnf.fr/BnF

Le lièvre et la tortue

Le lièvre et la tortue, fable illustrée par J.-B. Oudry, Dessaint et Saillant, 1755, gallica.bnf.fr/BnF
Rien ne sert de courir; il faut partir à point.
Le lièvre et la tortue en sont un témoignage.
“Gageons, dit celle-ci, que vous n’atteindrez point
Sitôt que moi ce but. – Sitôt? Êtes-vous sage?
Repartit l’animal léger.
Ma commère, il vous faut purger
Avec quatre grains d’ellébore.
– Sage ou non, je parie encore.”
Ainsi fut fait : et de tous deux
On mit près du but les enjeux.
Savoir quoi, ce n’est pas l’affaire,
Ni de quel juge l’on convint.
Notre lièvre n’avait que quatre pas à faire;
J’entends de ceux qu’il fait lorsque prêt d’être atteint
Il s’éloigne des chiens, les renvoie aux calendes
Et leur fait arpenter les langes.
Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter,
Pour dormir, et pour écouter
D’où vient le vent, il laisse la tortue
Aller son train de sénateur.
Elle part, elle s’évertue;
Elle se hâte avec lenteur.
Lui cependant méprise une telle victoire,
Tient la gageure à peu de gloire,
Croit qu’il y va de son honneur
De partir tard. Il broute, il se repose,
Il s’amuse à tout autre chose
Qu’à la gageure. A la fin quand il vit
Que l’autre touchait presque au bout de la carrière,
Il partit comme un trait; mais les élans qu’il fit
Furent vains: la tortue arriva la première.
“Hé bien! lui cria-t-elle, avais-je pas raison?
De quoi vous sert votre vitesse?
Moi, l’emporter! Et que serait-ce
Si vous portiez une maison?”
Jean de La Fontaine, Fables, Livre VI, 10
Source : La Fontaine, œuvres complètes, L’Intégrale/Seuil, 1965

La mort du loup – Alfred de Vigny
I.
Les nuages couraient sur la lune enflammée
Comme sur l’incendie on voit fuir la fumée,
Et les bois étaient noirs jusques à l’horizon.
Nous marchions, sans parler, dans l’humide gazon,
Dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes,
Lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes,
Nous avons aperçu les grands ongles marqués
Par les loups voyageurs que nous avions traqués.
Nous avons écouté, retenant notre haleine
Et le pas suspendu. – Ni le bois, ni la plaine
Ne poussaient un soupir dans les airs ; seulement
La girouette en deuil criait au firmament ;
Car le vent, élevé bien au-dessus des terres,
N’effleurait de ses pieds que les tours solitaires,
Et les chênes d’en-bas, contre les rocs penchés,
Sur leurs coudes semblaient endormis et couchés.
Rien ne bruissait donc, lorsque baissant la tête,
Le plus vieux des chasseurs qui s’étaient mis en quête
A regardé le sable en s’y couchant ; bientôt,
Lui que jamais ici l’on ne vit en défaut,
A déclaré tout bas que ces marques récentes
Annonçaient la démarche et les griffes puissantes
De deux grands loups-cerviers et de deux louveteaux.
Nous avons tous alors préparé nos couteaux,
Et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches,
Nous allions pas à pas en écartant les branches.
Trois s’arrêtent, et moi, cherchant ce qu’ils voyaient,
J’aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient,
Et je vois au-delà quatre formes légères
Qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères,
Comme font chaque jour, à grand bruit sous nos yeux,
Quand le maître revient, les lévriers joyeux.
Leur forme était semblable et semblable la danse ;
Mais les enfants du loup se jouaient en silence,
Sachant bien qu’à deux pas, ne dormant qu’à demi,
Se couche dans ses murs l’homme leur ennemi.
Le père était debout, et plus loin, contre un arbre,
Sa louve reposait comme celle de marbre
Qu’adorait les Romains, et dont les flancs velus
Couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus.
Le Loup vient et s’assied, les deux jambes dressées
Par leurs ongles crochus dans le sable enfoncées.
Il s’est jugé perdu, puisqu’il était surpris,
Sa retraite coupée et tous ses chemins pris ;
Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante,
Du chien le plus hardi la gorge pantelante,
Et n’a pas desserré ses mâchoires de fer,
Malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair,
Et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles,
Se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles,
Jusqu’au dernier moment où le chien étranglé,
Mort long-temps avant lui, sous ses pieds a roulé.
Le Loup le quitte alors et puis il nous regarde.
Les couteaux lui restaient au flanc jusqu’à la garde,
Le clouaient au gazon tout baigné dans son sang ;
Nos fusils l’entouraient en sinistre croissant.
Il nous regarde encore, ensuite il se recouche,
Tout en léchant le sang répandu sur sa bouche,
Et, sans daigner savoir comment il a péri,
Refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri.
II.
J’ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre,
Me prenant à penser; et n’ai pu me résoudre
A poursuivre sa Louve et ses fils qui, tous trois,
Avaient voulu l’attendre, et, comme je le crois,
Sans ses deux louveteaux la belle et sombre veuve
Ne l’eût pas laissé seul subir la grande épreuve ;
Mais son devoir était de les sauver, afin
De pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim,
A ne jamais entrer dans le pacte des villes
Que l’homme a fait avec les animaux serviles
Qui chassent devant lui, pour avoir le coucher,
Les premiers possesseurs du bois et du rocher.
III.
Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
Que j’ai honte de nous, débiles que nous sommes !
Comment on doit quitter la vie et tous ses maux,
C’est vous qui le savez, sublimes animaux !
A voir ce que l’on fut sur terre et ce qu’on laisse,
Seul, le silence est grand ; tout le reste est faiblesse.
– Ah ! je t’ai bien compris, sauvage voyageur,
Et ton dernier regard m’est allé jusqu’au cœur !
Il disait : ” Si tu peux, fais que ton âme arrive,
A force de rester studieuse et pensive,
Jusqu’à ce haut degré de stoïque fierté
Où, naissant dans les bois, j’ai tout d’abord monté.
Gémir, pleurer, prier, est également lâche.
Fais énergiquement ta longue et lourde tâche
Dans la voie où le sort a voulu t’appeler,
Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. “
Alfred de Vigny (1797-1863)
Publié dans La Revue des deux Mondes, 1843, 3e quinzaine.
La cigale et la fourmi

La cigale et la fourmi, fable illustrée par J.-B. Oudry, Dessaint et Saillant, 1755, gallica.bnf.fr/BnF
La cigale ayant chanté
Tout l’été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu’à la saison nouvelle.
“Je vous paierai, lui dit-elle,
Avant l’oût, foi d’animal,
Intérêt et principal.”
La fourmi n’est pas prêteuse;
C’est là son moindre défaut.
“Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
– Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
– Vous chantiez? j’en suis fort aise.
Et bien! dansez maintenant.
Jean de La Fontaine, Fables, Livre I, 1
Source : La Fontaine, œuvres complètes, L’Intégrale/Seuil, 1965