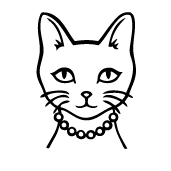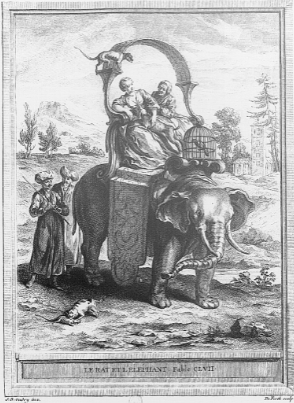Novembre
Les grand’routes tracent des croix
A l’infini, à travers bois ;
Les grand’routes tracent des croix lointaines
A l’infini, à travers plaines ;
Les grand’routes tracent des croix
Dans l’air livide et froid,
Où voyagent les vents déchevelés
A l’infini, par les allées.
Arbres et vents pareils aux pèlerins,
Arbres tristes et fous où l’orage s’accroche,
Arbres pareils au défilé de tous les saints,
Au défilé de tous les morts
Au son des cloches,
Arbres qui combattez au Nord
Et vents qui déchirez le monde,
Ô vos luttes et vos sanglots et vos remords
Se débattant et s’engouffrant dans les âmes profondes !
Voici novembre assis auprès de l’âtre,
Avec ses maigres doigts chauffés au feu ;
Oh ! tous ces morts là-bas, sans feu ni lieu,
Oh ! tous ces vents cognant les murs opiniâtres
Et repoussés et rejetés
Vers l’inconnu, de tous côtés.
Oh ! tous ces noms de saints semés en litanies,
Tous ces arbres, là-bas,
Ces vocables de saints dont la monotonie
S’allonge infiniment dans la mémoire ;
Oh ! tous ces bras invocatoires
Tous ces rameaux éperdument tendus
Vers on ne sait quel christ aux horizons pendu.
Voici novembre en son manteau grisâtre
Qui se blottit de peur au fond de l’âtre
Et dont les yeux soudain regardent,
Par les carreaux cassés de la croisée,
Les vents et les arbres se convulser
Dans l’étendue effarante et blafarde,
Les saints, les morts, les arbres et le vent,
Oh l’identique et affolant cortège
Qui tourne et tourne, au long des soirs de neige ;
Les saints, les morts, les arbres et le vent,
Dites comme ils se confondent dans la mémoire
Quand les marteaux battants
A coups de bonds dans les bourdons,
Ecartèlent leur deuil aux horizons,
Du haut des tours imprécatoires.
Et novembre, près de l’âtre qui flambe,
Allume, avec des mains d’espoir, la lampe
Qui brûlera, combien de soirs, l’hiver ;
Et novembre si humblement supplie et pleure
Pour attendrir le coeur mécanique des heures !
Mais au dehors, voici toujours le ciel, couleur de fer,
Voici les vents, les saints, les morts
Et la procession profonde
Des arbres fous et des branchages tords
Qui voyagent de l’un à l’autre bout du monde.
Voici les grand’routes comme des croix
A l’infini parmi les plaines
Les grand’routes et puis leurs croix lointaines
A l’infini, sur les vallons et dans les bois !
Emile Verhaeren,
Les vignes de ma muraille, 1899